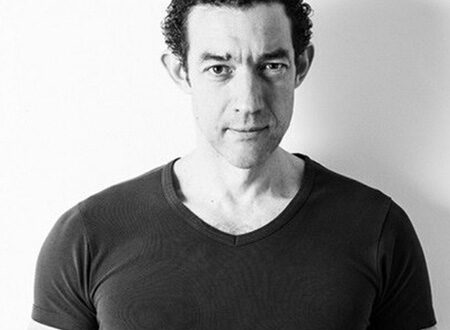Bouquiner
Liseuse au lit
Depuis toujours, pour moi, livre et lit sont associés. Cela remonte à l’âge analphabète où l’on me lisait des contes « à dormir debout» dès que j’avais sauté dans mon petit pageot. Je me couchais sans histoire grâce aux histoires.
Je n’aimais pas qu’on me les raconte, j’aimais qu’on me les lise. Je surveillais l’envolée des pages et savais à quelle épaisseur du volume retrouver mes héros quand la patience de mes lecteurs s’épuisait. Car elle s’épuisait, alors que, morte de sommeil, j’en redemandais encore.
Une seule solution pour m’affranchir de leur paresse: apprendre à lire. J’ai appris, avec les uns, les autres, chacun sa méthode. Si bien, ou plutôt si mal, que je n’ai jamais su égaler leur grand art : lire à haute voix, avec le ton, sans écorcher les noms propres (aujourd’hui encore, j’ânonne, j’estropie les patronymes, les noms de lieux. Les romans russes sont délicesupplice: je photographie ce fatras de consonnes qui ralentit ma lecture et je m’emmêle les pinceaux au troisième Karamazov. Ce qui ne m’empêche pas de vocaliser sur tous mots exotiques: Raskolnikov, T éotihuacan, Ziguinchor … ).
Enfin, je me débrouillais, lisant jusqu’à pas d’heure. Mais, toujours, une voix impérieuse m’ordonnait d’éteindre. Trahie un soir par le rai de lumière sous la porte, comme tous les enfants liseurs, je passai au stade de la lampe de poche, suffoquant sous les draps, avec de brefs périscopages pour respirer. Quand les adultes sortaient, revenue à la surface, à la clarté de la lampe de chevet, je lisais tout mon soûl. Leurs pas dans le couloir sonnaient l’extinction des feux dans un affolement total.
Je jouis de cette liberté jusqu’à la nuit où ma mère se brûla à l’abat-jour de la lampe-pince en venant m’embrasser dans mon faux sommeil. Après ce flagrant délit, il me fallut, pour plusieurs années, replonger dans la clandestinité Wonder.
Bref, je ne lis bien qu’au lit, ou plutôt allongée. Jadis sur le ventre, aujourd’hui sur le dos, solidement calée par deux oreillers. La lecture assise reste associée à l’école, au travail, à la contrainte par corps. Une part du plaisir s’envole. Sauf dans le métro.
Il me faut lire avant de ID endormir. Même à quatre heures du matin, j’ai besoin de ma dose. Mon œil gauche se fatiguant plus vite que le droit, je ne lis que d’un œil, jusqu’à épuisement. Incapable de ID arrêter en fin de chapitre, de paragraphe ou de ligne, je stoppe, en pleine phrase, foudroyée.
Marque-page
Sans être fétichiste, je ne saurais corner les pages. Je ne peux pourtant me résoudre à adopter le signet. D’où cette habitude d’ouvrir franchement les livres (sauf ceux qu’on me prête), d’en casser le dos, de les poser en accent circonflexe. Je hais les couvertures rigides, qui n’autorisent qu’une lecture parcimonieuse et dont l’impeccable alignement dans les bibliothèques donne une impression de jamais lu.
Le matin, dans le métro, je laisse au livre le soin de s’ouvrir là où il faut. Et, bille en tête, j’entame ce que j’ai lu la veille au soir dans un semi-coma. Un sursaut de lucidité me fait avancer de dix pages. C’est trop. Je reviens en arrière. M’y voilà. Je suis à l’œuvre pour au moins dix stations. La gitane muette ou le tonitruant « Pardon de vous déranger, je suis chômeur» m’indiffèrent. Je tends ma pièce sans décoller de mon bouquin. Et je m’abomine. Plus tard, un air d’accordéon plein pot ou l’oppressant boum-boum d’un walkman qui fuit m’arrachent à ma lecture. Je change de wagon. Page perdue! l’erre à nouveau de paragraphe en paragraphe. Ouf, ça y est! Zut, j’ai raté Pont-Neuf.
Malgré ces déboires, rien ne me fera adopter un marque-page et jamais je ne cornerai mes livres.
Pas question non plus de les annoter. Or, j’ai parfois besoin de repères. Donc, en marge de la ligne fautive ou de l’expression mémorable, je donne un coup d’ongle appuyé. Et passe pour folle quand, inclinant mon bouquin en tout sens, ou le tâtant du bout des doigts telle lecteur de braille, j’essaie de déceler le trait embouti dans l’épaisseur du papier. Le regard sournois des voisins me fait reporter ma traque à plus tard. Le soir, sous le rayon précis de l’halogène, je retrouve la trace fantôme. C’est alors que se dessine entre mes sourcils un point d’interrogation. Pourquoi cette fureur ou cette ferveur ?
Je n’aime pas ces signes impudiques qui trahissent son propriétaire, ses enthousiasmes, le rythme de sa lecture. En revanche, je ne déteste pas ce qui, sur l’instant, me consterne: le rond sépia d’une tasse de café, la tache de graisse qui rend le papier un rien transparent. J’adore qu’un peu de sable gaufre les feuilles, arrondisse la tranche, que trois pétales de pavot voltigent, qu’une fleur des champs à identifier plus tard tombe à la faveur d’un rapide feuilletage. Mieux que tout commentaire, ils me rappellent le lieu, les odeurs, la saison et les gens.
Je réprouve les notes marginales, mais je peux sans émoi, faute d’autre papier, dessiner sur la dernière page (et sur elle seulement) le portrait d’une dame dans le bus, mon pied d’où pendouille une sandale, ou écrire une diatribe contre mon compagnon en sanglotant sur le divan de la mezzanine.
Je répugne au marque-page, mais mes livres sont fourrés d’articles, de vieilles lettres, de listes de courses. Saisis au hasard, ils exhalent leurs secrets oubliés. Libérés de l’étreinte de leurs voisins, ils se regonflent de souvenirs aussi puissants que la dédicace de l’auteur ou du donateur. Ils vivent doublement, de leur histoire et de la mienne.
Prêts
Autant dire que prêter est un problème. Il faut expurger le livre, le déshabiller, le désensabler, l’arracher à son rayonnage, le dépayser.
En réalité, il y a deux cas de figure: les prêts sollicités et les prêts spontanés.
Qui n’a pas redouté cet œil fureteur, ce doigt qui traîne sur les tranches et qui s’arrête. Là. Le livre est condamné. On ne le reverra plus. Le cœur se serre. Pas celui-là. Pas à lui, pas à elle, qui ne rend jamais rien ou Dieu sait quand. Un jour, j’ai osé mentir: « Désolée, on me l’a prêté. » « Mais non, il est à toi. Il y a une dédicace dessinée par François. » Cramoisie, j’ai cédé. Pan. C’est moi qui ai donné le coup de grâce.
Mine de rien, il faut reprendre le livre, le feuilleter, le dépouiller de son misérable petit tas de secrets. Le sable tombe, le pétale se désagrège, un billet de 500 balles voltige. Chic. Mais le livre-bas de laine est perdu. Et comment en soustraire la diatribe assassine? « Deux: secondes, il faut que je note une citation. » La mort dans l’âme, je m’éclipse; je détache la dernière page avec la précision d’un dissecteur. Cet appendice, cette petite boule de chagrin froissé va à la poubelle. D’où, le soir, je l’extirperai pour la fourrer ailleurs, avant de la jeter à jamais après cette courte nuit de sursis.
Souvent, le livre est muet, vierge de toute trace. Prêtable sans amputation. Mais tout aussi perdu. Moyennement aimé, on ne le rachètera pas. Adoré, remplacé dès le lendemain, il sera là, fringant. Mais vide et creux:. Ah! cette dernière édition de l’Éloge de l’ombre attendant une relecture sous sa nouvelle couverture. J’en détourne les yeux: avec tristesse. Que j’aimais mon vieil exemplaire fatigué!
Le prêt spontané est encore plus accablant.
Masochiste, on est l’artisan de son propre malheur. Avec, en prime, l’auréole de la générosité ou le remords de la suffisance: « Comment, tu n’a pas lu Le Sang noir?»
Les dîners entre amis condamnent les livres de l’hôte. Pour un peu, la bibliothèque y passerait. Après leur départ, une même question me taraude en rangeant les verres dans le lave-vaisselle: le problème n’est plus de savoir si l’ami rendra le livre, mais s’il l’aimera. S’il l’aime, il y a de bonnes chances qu’il le garde. Mais s’il ne l’aime pas, est-ce réellement un ami? S’il n’aime pas Le Sang noir! Les jours, les semaines passent. Bon, après tout, c’est un gros volume. l’aurais dû lui prêter OK foe ou La Maison du peuple.
Souvent, la mémoire charitable oublie le prêt pour oublier l’affront. Mais un soir, le même, chez lui, dit à un autre convive: « Comment, tu n’as pas lu Le Sang noir! Mais c’est un chef-d’ œuvre. » La reconnaissance m’inonde. Et un espoir fou me traverse. « Ah ! ça t’a donc plu. Et si tu me rendais mon exemplaire? » « Mon Dieu, c’est vrai, c’était le tien. Je l’ai prêté à Marie. »
En rentrant, je repense au Sang noir, lu il y a trente ans, à demi oublié, à Cri pure, à ses monstrueux: panards, aux: petits chiens qui ont boulotté la Chrestomathie, au type qui colle des timbres sur des assiettes (non, ce n’est pas possible, j’ai dû inventer ça), à Louis Guilloux, ses cheveux blancs à la Liszt, son regard malicieux, son doigt si commodément crocheté pour bourrer ses pipes, à sa petite chanson préférée qui se terminait par: « Et les Binicats, qui sont de brav’gars, les ont r’poussés jusqu’à Jersey. »
Pour Le Sang noir, au fond, ce n’est pas grave. J’en ai deux exemplaires. Plus celui de François. Plus celui de Bollène. Et puis, Marie le rendra peut-être. Ou le prêtera. L’essentiel, c’est qu’on ait aimé Guilloux.
Ainsi vont les livres.
Emprunts
Pas plus qu’eux à moi, je ne peux résister à ceux qui me recommandent un nouvel auteur. Je note le titre dans ma tête, au revers d’une enveloppe, plus sûrement dans mon agenda. Mais parfois, avant d’avoir pu retenir ma langue, je lâche le fatidique: « Tu me le passes? » Et les ennuis commencent. Outre que j’inflige aux autres les affres du prêt, je m’impose les tourments de l’emprunt.
Un livre emprunté est sacré. J’ai appris ça, enfant, une nuit d’été où un incendie menaçait notre immeuble. Ma mère fut une des dernières à évacuer les lieux, en chemise de nuit, un livre sous le bras. Un livre emprunté qu’elle avait mis un temps fou à retrouver alors que nos voisines superposaient leurs fourrures et rassemblaient valeurs et bijoux que, du reste, ma mère n’avait pas.
Oui, un livre emprunté est sacré. L’ouvrir semble déjà une profanation. On le ramène crispé sur son sac comme une pensionnée qui vient de toucher son mandat à la poste. Toute perte, tout vol seraient pires qu’une catastrophe : un déshonneur. Arrivé chez soi, on le place sur la pile à part, la pile reproche, la pile des urgences. S’il faut voyager, plutôt que de l’abandonner au coffre de la voiture ou à la soute de l’avion, on le serre dans son bagage à main, même s’il pèse déjà un âne mort. Au lieu de le laisser décanter parmi les livres en attente, il faut l’écluser cul sec, à toute vibure. On le couvre par obligation, on le couve. On traversera tout Paris dans la minute pour le récupérer dans un bistrot. On l’ouvre à peine de peur de casser son dos, d’où l’impression de ne lire que la moitié gauche des pages paires et la moitié droite des pages impaires. Pas étonnant que je garde un souvenir mitigé de Givre et Sang de Powys que Jean-Robert m’avait prêté, comme neuf.
Impossible de le reposer ouvert à côté du lit quand le sommeil me saisit. De le reprendre au petit déjeuner de peur de l’éclabousser de café. De le refermer un peu vivement, de crainte qu’un possible moucheron y laisse une cruelle macule beige.
Pourquoi ne pas l’avoir acheté? D’autant qu’il est bon. Je souhaiterais le garder pour le relire. Je vais l’acheter, d’ailleurs. Mais il aura l’air tout couillon, lu mais pas même ouvert. Ce que j’aimerais, c’est garder cet exemplaire là et rendre le neuf. Mais voilà, le prêteur n’est pas d’un autre bois que moi. Il aime son exemplaire, qui est un peu devenu le mien. Enfin pas vraiment. Le souvenir de cette lecture vétilleuse a affadi mon plaisir. L’envie de l’acheter s’estompe.
Avant de le rendre, il passe à l’inspection. Je retire sa liseuse de cellophane. Aie, cette déchirure, c’est moi? Impossible, il était couvert. Puis feuilletage méthodique. Je souffle sur les grains de tabac. Qu’est-ce que c’est que ce trait de crayon? Ça, au moins, j’y suis pour rien. Faut-il le gommer? Oui. Non: c’est probablement une marque intentionnelle. Et cette tache de graisse, quelle horreur! Ah oui, je l’avais remarquée, elle y était déjà. Quand même, un peu de terre de Sommières. Bref, restauration générale: époussetage, gommage très léger, dégraissage, lissage, encollement. Soit trois quarts d’heure d’un travail de bénédictin (la pose de Néoprène demande déjà cinq minutes), avec, en prime, le risque d’effacer les traces chéries par le prêteur, ces traces qui lui restituaient … le lieu, les odeurs, la saison et les gens associés à sa première lecture. Quoi qu’il fasse, l’emprunteur est toujours un sagoum.
Et les bibliothèques alors, ces prêteuses institutionnelles qui affranchissent l’emprunteur de cette crainte du viol? Justement, les livres m’y semblent comme des putes à l’abattage, en carte. Et les lecteurs comme des fétichistes opérant leur choix maniaque dans l’atmosphère recueillie des rayons spécialisés, consommant dans une promiscuité de bordel de campagne sous la surveillance des assis. Pauvres bibliothécaires! Ils ont bien changé depuis les vitupérations de Rimbaud. Et s’ils récriminent encore, ce n’est certainement pas contre un lycéen qui réclamerait l’œuvre de Restif de la Bretonne mais plutôt contre ceux qui ignorent jusqu’à son existence. D’ailleurs, selon Libération, le nouveau problème des assis, ce sont les « debouts », ceux qui lisent sur place, devant les rayonnages, encombrant les travées.
Annie François.
Bouquiner.
Seuil, 2000.

 Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris