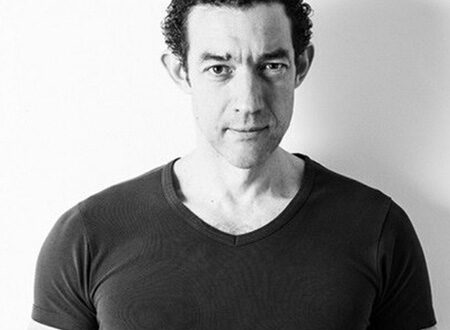Europe
J’ai été incité à la littérature par la poésie du XXe siècle. C’était la seule forme à la hauteur du siècle le plus meurtrier, carcéral et migratoire de l’histoire humaine.
La poésie a pu répondre à la question : « Est-ce que vous pouvez décrire ça ? »
La poétesse Anna Akhmatova la reçoit et y répond dans un sursaut de vérité inattendue et improvisée.
Au cours des années 1950, dans la ville qui s’appelait alors Léningrad, à la queue sur le trottoir devant la porte verrouillée d’une prison : voilà les conditions nécessaires à cette question.
Détails supplémentaires : c’est l’hiver, la file des parents attend depuis de nombreuses heures la grâce d’une autorisation de visite ou la disgrâce d’un refus.
Une femme tout engourdie dans la file apprend qu’on a reconnu une poétesse derrière elle. Elle est là avec eux non comme témoin, mais parce que son fils est dans les barreaux.
On n’est pas derrière les barreaux, mais dedans, comme dans les mâchoires d’un étau.
La femme engourdie n’a sans doute rien lu d’Anna Akhmatova, mais elle a une définition du poète : celui qui sait extraire les mots de la glace.
Dans un endroit du monde où je suis allé il y a encore des tailleurs de glace qui apportent au marché les blocs qu’ils extraient. La femme se moque bien de ça, l’existence des pauvres se débrouille avec les métiers étranges, elle apporte bien des larves de cafards au marché.
Une poétesse donc : elle peut lui poser la question que la poésie en personne était susceptible de recevoir avant même l’existence d’Homère.
« Est-ce que vous pouvez décrire ça ? »
Anna répond par un olé de torero qui plonge son « espada en la cruz », le point où les omoplates du taureau croisent sa colonne vertébrale. C’est là qu’est la perfection : dans la cruz.
Anna répond : « Je peux », avant tout autre syllabe.
Par sa bouche, la poésie se charge de la tâche demandée par la femme engourdie, plantée dans la file.
À partir de ce moment-là, chaque lecteur est en mesure de savoir qu’au sommet des littératures se trouve le point culminant, les vers.
Je peux : ce n’est pas une volonté de puissance, mais de mise au service, au sacrifice. Anna a enseigné à son fils le risque de la liberté. Il la purge à présent dans la réclusion, pour l’avoir apprise d’elle, pour lui avoir obéi.
C’est bizarre, pourtant c’est ainsi : la liberté ne dépend pas d’un choix, mais d’une inexorable obéissance à un commandement.
« Tempête sacrée est la nécessité/qui n’écoute pas la prière humaine. » Hölderlin voit dans le poète le tatouage gravé par la coercition de la « Ananké » grecque.
C’est pourquoi au XXe siècle les prisons, les camps de concentration, les exils ont dans leurs listes les noms des poètes.
J’ai lu dans le plus grand désordre, seul ordre adapté à un lecteur. Les systématiques ne veulent pas lire, ils veulent avoir déjà lu.
J’ai écouté Lorca dans un disque gravé par la voix d’un acteur qui l’imprimait à chaud dans les oreilles.
On vendait alors des disques sans musique, les paroles suffisaient.
C’est mon père qui les achetait. Le soir, il répétait par cœur les vers avec le disque.
De Lorca mis contre un mur et fusillé, il me reste en mémoire un vers nocturne :
« Les phares s’éteignirent et les grillons s’allumèrent. »
L’ouïe s’ouvre en grand dans le noir.
J’ai escaladé de nuit à la lumière d’une frontale les pentes infinies de haute altitude. Je connais le bruit des pas qui enfoncent leurs pointes dans les névés et vont au rythme intérieur du cœur et de la respiration.
Je sais que le silence n’existe pas. L’ouïe perçoit en ces heures-là, à travers l’obscurité, à la fois le très proche et le lointain.
Les poètes du XXe siècle scandent leurs syllabes à une allure de montée.
Je lis les quinze psaumes dits « Maalot », des montées dans les pèlerinages vers les hauteurs de Jérusalem. « Nous étions tels des rêveurs », mais dans un état de veille concentrée, absorbés par l’acte de souffler les syllabes des vers au-dessus du rythme des pas qui avançaient.
Les poètes du XXe siècle allaient toujours vers le haut, du moins ceux qui ne se sont pas bouclés chez eux pour pleurer, alors que la majuscule Histoire coupait la forêt et en faisait voler les éclats.
Il y a larmes et larmes. « Lishnie » inutiles, dit-on en russe pour celles qui sont gaspillées. Ou bien la prodigieuse larme que Fleming enrhumé laissa tomber sur une culture de bactéries. Le contraire des larmes, c’est le soldat Giuseppe Ungaretti qui l’écrit, une nuit où il se trouve près du corps d’un camarade massacré et se met à écrire des lettres pleines d’amour, en déclarant au dernier vers :
« Je n’ai jamais été autant/attaché à la vie. »

 Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris