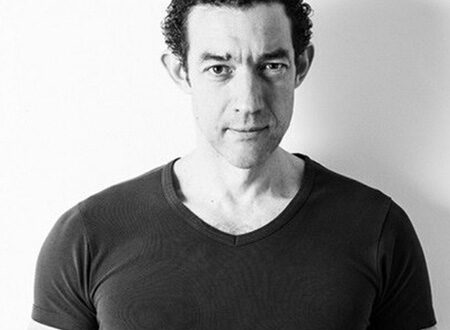Obéir
Les monstres existent, mais ils sont trop peu nombreux pour être vraiment dangereux ; ceux qui sont plus dangereux, ce sont les hommes ordinaires, les fonctionnaires prêts à croire et à obéir sans discuter.
Primo Levi
Je reprends, en guise d’entame – paradoxale – la provocation d’Howard Zinn[1] : le problème, ce n’est pas la désobéissance, le problème, c’est l’obéissance[2]. À quoi fait écho la phrase de Wilhem Reich : « La vraie question n’est pas de savoir pourquoi les gens se révoltent, mais pourquoi ils ne se révoltent pas[3]. »
Les raisons de ne plus accepter l’état actuel du monde, son cours catastrophique, elles sont presque trop nombreuses. Les épeler toutes reviendrait à une litanie des désastres.
Je ne retiendrai ici que trois, quatre motifs massifs qui auraient dû depuis longtemps susciter notre désobéissance et devraient la provoquer encore aujourd’hui puisqu’ils ne font, sous nos yeux, que s’aggraver.
Et pourtant rien n’arrive, personne ou presque ne se lève.
Le premier, c’est bien sûr le creusement des injustices sociales, des inégalités de fortune. L’annonce de Marx (la paupérisation radicale) se réalise toujours davantage[4], comme si la globalisation avait permis enfin, après les blocages des nationalismes économiques, que se déploie dans toute son extension un capitalisme effréné, total, dont l’issue actuelle est la constitution d’une élite richissime, une minorité de gavés à mort, suffoquant sous le poids de leur fortune, face aux 99 % de dépossédés, traînant leur dette ou leur misère au bout des mains. Les spirales strictement complémentaires d’appauvrissement des classes moyennes et d’enrichissement exponentiel d’une minorité sont en place, démultipliées par les nouvelles technologies qui annulent les effets de retardement, de « frottement[5] » qui maintenaient jusque-là des équilibres raisonnables. Le processus s’accélère, il s’emballe. La rationalité actuarielle, celle des « assurances » (le calcul froid des risques), impose de faire payer partout l’argent cher à ceux qui n’en ont pas. Elle a pour elle une évidence arithmétique glacée qui, à peu de frais, lessive l’âme des décideurs économiques, de tous ceux qui, tenant en main la liste du prochain fourgon de licenciés, peuvent dire, l’air pénétré de condescendance humiliante : « Que voulez-vous, c’est bien malheureux, mais enfin les chiffres sont les chiffres, et on ne va pas contre la réalité des chiffres. »
Sauf que la « réalité » des chiffres est introuvable, en dehors de son assise dans leur bonne conscience[6]. Ou plutôt non : la réalité des chiffres, c’est celle des effets de réalité produits, durs et terribles. Quand les équations sont prises comme source d’autorité, les tableaux Excel voix d’oracles devant lesquels on baisse respectueusement la tête, levier des décisions, alors les désespoirs sociaux, les misères de fins de mois, les déclassements, les ruines sont d’avance justifiés. Et tout cela a lieu « conformément » à la loi d’airain de l’économie, à la « réalité » incontournable des équations : les chiffres sont les chiffres.
Quelle réalité ? Pas celle, étouffée, des solidarités interindividuelles, du sens élémentaire de la justice, de l’idéal de partage. Pas l’épaisseur des réalités humaines, que les dirigeants – les « responsables » comme on dit, par ironie sans doute – dans un mélange d’indifférence et de calcul, oublient, dissimulent, se cachent à eux-mêmes derrière l’écran de leurs statistiques imprimées sur du papier brillant.
Et quelle loi « supérieure » ? Je ne vois surtout qu’une cupidité éhontée. Où est la providence qu’ils invoquent ? Et la nécessité immanquable ? Je comprends que les puissances de pouvoir et d’argent puissent à ce point, quand on leur en fournit l’occasion, apporter témoignage de leur foi. À voir la piété affichée des dirigeants d’entreprises, j’ai cru longtemps à l’hypocrisie. Et pourtant non. Le cynisme est parvenu à un degré supérieur, presque éthéré, où il n’est pas détachable de la sincérité. Car les lois de l’économie et les décrets de Dieu se ressemblent, flottant dans cette transcendance qui les fait se confondre, propageant une inéluctabilité qui « s’impose » à tous sans exception, comme le temps qu’il fait et la mort qui viendra. C’est à ce point que, de se trouver immensément privilégié, bénéficiaire de l’ordre du monde – face à la masse dont le destin n’est plus désormais que de survivre – cela rendrait presque humble. Où l’on se dit que tant de déraison – cette monstruosité démente des inégalités – doit avoir une explication supérieure, théologico-mathématique au moins, et ne serait que de surface. C’est bien là la fonction atroce de l’introduction du formalisme mathématique en économie : innocenter celui qui engrange les bénéfices. Non, il n’est pas le salaud de profiteur qui fait crever l’humanité, mais l’humble serviteur de lois dont la souveraineté, la complexité échappent au commun des mortels. J’entends la voix de ces dirigeants surpayés, de ces sportifs millionnaires. Ils se donnent une conscience facile en opposant : « Mais enfin, ces émoluments exorbitants, je ne les ai pas exigés, on me les a proposés ! C’est bien que je dois les valoir. » Allez dire aux travailleurs surexploités qu’ils méritent leur salaire et qu’ils sont sous-payés parce qu’ils sont des sous-hommes.
Le double processus de l’enrichissement des riches et de l’appauvrissement des pauvres entraîne l’effondrement progressif de la classe moyenne[7]. L’arrogance ou le désespoir : il existe de moins en moins de réalité intermédiaire entre ceux qui exigent depuis leurs fauteuils capitonnés la majoration maximale de leurs actions et ceux auxquels on impose la diminution de ces salaires bientôt insuffisants, je ne dis même pas pour vivre, mais pour rembourser leurs dettes. La vie, c’est le très peu qui reste une fois qu’on a payé les banques. Les règles de solidarité les plus élémentaires s’effritent. La réalité humaine se dissout et il ne reste plus, dans les salons dorés des dirigeants légèrement pensifs et vautrés, que Dieu et les équations, alors que, dans l’autre monde, on se déchire les miettes. Avec la disparition de la classe moyenne, c’est l’existence d’un monde commun qui se perd – les idéaux d’utilité générale, de bien public ayant toujours eu comme fonction de préserver la consistance d’une classe moyenne qui imposait des limites à l’extrême misère et à l’extrême richesse, et constituait, comme l’écrivait il y a plus de vingt siècles Euripide dans ses Suppliantes, la possibilité même de la démocratie[8].
Pourtant la cassure n’attise pas excessivement encore la haine politique du peuple contre les nantis. Elle se diffracte en une série indéfinie de divisions internes. Parce que la condition des plus aisés suscite surtout la passion amère de leur ressembler, parce que la fierté d’être pauvre, alimentée par l’espérance de revanches futures, a laissé place à une honte agressive, parce que le message véhiculé partout est qu’il n’y a de sens à vivre que dans la consommation à outrance, en se laissant aspirer par le présent dans une jouissance facile. Pour ces raisons, et d’autres encore, la colère juste d’une majorité exploitée contre la minorité est court-circuitée, redistribuée en haine des petits profiteurs et peur des petits délinquants.
La vitesse d’enrichissement des possédants augmente, la spirale du déclassement s’accélère. La richesse des puissants défie l’imagination, et la détresse de ce qu’on appelait autrefois les « fins de mois » – mais aujourd’hui ce sont les dix, les vingt ans à venir qui sont obérés – n’est pas représentable dans les hautes classes qui ne sursautent que devant les variations de leurs profits immenses. Parler d’« injustice » est devenu obsolète. Nous sommes à l’âge de l’indécence. Les rémunérations des dirigeants de grandes entreprises, les salaires des sportifs ultra-médiatisés, les émoluments des artistes sont devenus obscènes. Les inégalités sont parvenues au point où seule l’hypothèse de deux humanités pourrait les justifier.
Le deuxième intolérable de notre monde actuel, c’est la dégradation progressive de notre environnement. L’air, les sols et ses « produits », la végétation : tout est pollué, encrassé jusqu’à la suffocation. La Nature s’était pourtant depuis toujours définie par sa capacité de renouvellement, de répétition du Même. On disait : les productions culturelles s’usent, vieillissent et meurent, la Nature au contraire est un Printemps essentiel. Tout, chaque fois, recommence. Éternelle répétition du Même, incessant redépart, réapparition magique des mêmes formes, fraîcheur inaltérée. Le chœur d’Antigone chantait « la Terre infatigable » (vers 339). Eh bien la Terre s’est fatiguée, le XXIe siècle sera celui de l’épuisement et du désert. L’humanité pose à la Nature la question de ses limites. Fécondité des terres exténuée, ressources taries, stocks épuisés.
Frédéric Gros.
Désobéir.
Albin Michel, 2017.

 Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris