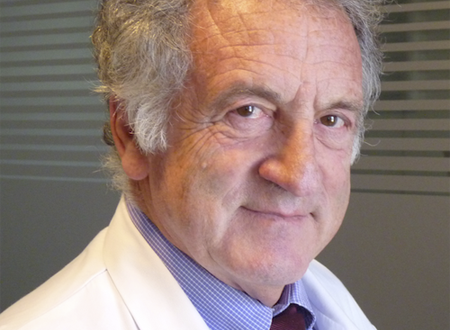Pourquoi ?
Héroïsme et barbarie
Giacomo Trivulzio a eu un jour cette formule : « Pour faire une guerre, il faut trois choses : de l’argent, de l’argent et… de l’argent(1) ! » On doit remettre la phrase dans son contexte : Trivulzio était un entrepreneur de guerre de la Renaissance, un condottiere rassemblant et finançant des armées de mercenaires qu’il mettait sur le marché et vendait au plus offrant pour des « coups politiques ».
C’est vrai que le coût de la guerre est toujours effarant – souvent bien supérieur au profit économique que pourraient en escompter les agresseurs. On s’en est une nouvelle fois rendu compte au printemps 2022 avec les annonces par l’Europe ou les États-Unis de milliards d’euros ou de dollars « débloqués » pour fournir aux forces ukrainiennes combattantes du matériel militaire. La guerre est tellement dépendante de l’argent que la victoire pourrait même sembler mécaniquement accordée à qui sera prêt à investir le plus de richesses pour la remporter.
Pourtant, les contre-exemples à cette « évidence » n’ont jamais manqué dans l’histoire : l’écrasante supériorité matérielle des Américains n’a pas empêché leur désastreuse et ruineuse défaite au Vietnam. Les experts comme les acteurs de la guerre n’ont jamais cessé de dénoncer l’insuffisance d’un constat au demeurant un peu plat : c’est toujours la plus grosse armée qui l’emporte, et ont perpétuellement mis en avant ce qu’on appelait autrefois les « forces morales » – je veux parler de l’engagement éthique, de l’énergie spirituelle, du désir qu’on met à se battre (pour attaquer ou se défendre, pour riposter ou détruire), de la qualité morale de la volonté belligérante.
Cette remarque peut apparaître curieuse tant la guerre est devenue pour nous synonyme de barbarie, d’atrocité sauvage. La lecture des textes nous oblige pourtant à reconnaître que l’expérience de la guerre a été, des plages de Marathon à celles de Normandie, une matrice formidable de vertus. Le terme crucial de la morale occidentale (la vertu – aretê en grec et virtus en latin) renvoie d’ailleurs étymologiquement au courage du soldat, à sa détermination. La valeur morale a la même racine que la vaillance militaire. La guerre est d’ailleurs saturée de figures éthiques : le chevalier loyal et preux, le soldat-citoyen épris de liberté et prompt à mourir pour sa cité, etc. Mais ne s’agit-il pas alors d’une guerre idéalisée, sublimée ? Ou plutôt : ne faut-il pas, pour pouvoir faire de la guerre une expérience morale, supposer des modalités de combat où ce n’est pas encore la compétence technique qui prévaut mais l’engagement d’une vie ?
Or, si la guerre a pu être réfléchie pendant des siècles comme un laboratoire de vertus, elle n’a cessé, en même temps et a contrario, d’être dénoncée comme ce moment cruel de retour à une bestialité primitive, de remontée de pulsions archaïques. En même temps que de courage héroïque, le guerrier peut faire preuve de sauvagerie inhumaine. Paradoxe, ambivalence, contradiction, la guerre, du point de vue moral, est bipolaire. La guerre est un moment d’exaltation et d’effondrement de la morale, un point de surgissement et de débâcle éthiques. Il est certes possible, et parfois légitime, de résoudre la contradiction en divisant, comme cela est inlassablement répété à propos du conflit ukrainien, les belligérants selon cette dualité. On opposera alors à des Russes barbares et ivres de sang des Ukrainiens héroïques et tenaces. Ce dualisme est d’autant plus soutenable et crédible qu’il recouvre une opposition entre des forces d’agression composées de soldats-mercenaires et des forces de défense comprenant surtout des citoyennes et des citoyens se battant pour leur territoire et leur autonomie. Mais le vrai mystère serait évidemment de pouvoir comprendre comment cet antagonisme déchire secrètement le cœur humain.
Frédéric Gros.
Pourquoi la guerre.
Albin Michel, 2022.

 Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris