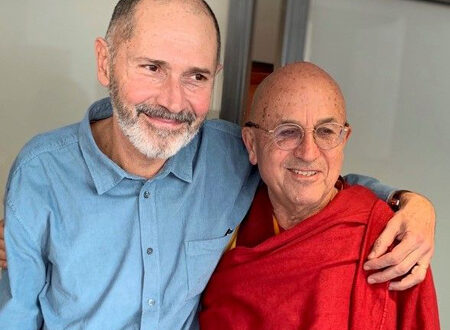Économie de marché
Pour restaurer un État stratège, je partage quelques directions qui pourraient être considérées. Elles ne sont pas exhaustives ni correctement pondérées. Elles sont autant de pressentiments que j’offre à la critique.
Toutes s’inscrivent dans l’intuition que les prochaines années exigeront d’assister au retour de l’État éclairé, au titre d’acteur dominant de l’économie, sous forme d’impulsions stratégiques. Je suis d’ailleurs convaincu que la fin de la parenthèse néolibérale va s’accompagner de nationalisations ou d’étatisations de pans entiers de l’économie, faute d’avoir pu trouver une tempérance du secteur privé, trop longtemps autorégulé dans de nombreux secteurs proches des besoins de base des citoyens.
L’État ne peut plus abandonner sans contrôle ses attributs régaliens au profit d’une économie de marché. D’ailleurs, sans ordonnancement étatique, l’économie de marché est vouée à succomber sous ses propres excès puisqu’elle ne connaît aucune régulation sinon l’expression du prix formé par les lois de l’offre et de la demande.
Certains préconisent la mutation des démocraties représentatives en démocraties participatives. Pendant longtemps, j’ai postulé que ce serait une erreur, puisque cela accentuerait la délégation de l’expression politique aux fluences, parfois émotives, des réseaux sociaux. Je me suis aussi interrogé sur le fait de savoir si les démocraties participatives n’étaient pas, pour partie, de la poudre aux yeux lancée par des oligarchies politiques en déshérence de solutions aux défis sociétaux.
Les mécanismes de démocratie participative peuvent contribuer à éclairer la représentation citoyenne, mais ils ne peuvent pas s’y substituer. Pourtant, face à l’envergure des problèmes et des choix sociétaux, il m’apparaît qu’une représentation démocratique plus large s’impose. Il n’est plus tolérable que les décideurs soient confinés dans un isolement dont les légitimités institutionnelles et démocratiques sont extrêmement fragiles. On peut imaginer des consultations associant le citoyen et le monde académique à toutes les étapes de la décision publique. Cela conduit au concept de démocratie délibérative, développé par Jürgen Habermas, déjà cité, fondée sur une discussion citoyenne préalable à la discussion politique, que les Anglo-Saxons englobent sous le vocable empowerment. Jürgen Habermas considère que la légitimité d’une décision politique ne repose pas sur l’autorité qui la commet, mais sur un processus délibératif public qui conduit idéalement à un consensus entre les parties concernées.
En revanche, je suis incrédule quant à la démocratie digitale. On pourrait théoriquement imaginer que la diversité des opinions contribue à un débat démocratique enrichi. Pourtant, on réalise que les réseaux sociaux ont tendance à encercler leurs utilisateurs dans des convictions dont ils alimentent le caractère souvent sectaire, voire tribal.
Bruno Colmant.
Une brûlante inquiétude.
Renaissance du livre, 2024.

 Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris