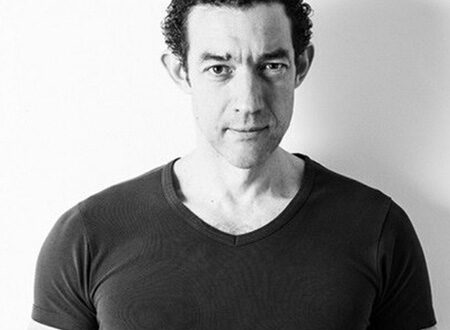Désorientale
L’escalator
À Paris, mon père, Darius Sadr, ne prenait jamais d’escalator.
La première fois que je suis descendue avec lui dans le métro, le 21 avril 1981, je lui en ai demandé la raison et il m’a répondu : « L’escalator, c’est pour eux. » Par eux, il entendait vous, évidemment. Vous qui alliez au travail en ce mardi matin d’avril. Vous, citoyens de ce pays, dont les impôts, les prélèvements obligatoires, les taxes d’habitation, mais aussi l’éducation, l’intransigeance, le sens critique, l’esprit de solidarité, la fierté, la culture, le patriotisme, l’attachement à la République et à la démocratie, avaient concouru durant des siècles à aboutir à ces escaliers mécaniques installés à des mètres sous terre.
À dix ans, je n’avais pas conscience de toutes ces notions, mais le regard désarmé de mon père – attrapé durant les mois passés seul dans cette ville et que je ne lui connaissais pas – m’ébranla au point qu’aujourd’hui encore, chaque fois que je me trouve face à un escalator, je pense à lui. J’entends le bruit de ses pas qui grimpent les marches dures de l’escalier. Je vois son corps légèrement penché en avant par l’effort, obstiné, volontaire, ancré dans le refus de profiter du confort éphémère de l’ascension mécanique. Dans la logique de Darius Sadr, ce genre de luxe se méritait, sinon c’était de l’abus, voire du vol. Son destin s’inscrivait désormais dans les escaliers de ce monde, le temps qui s’écoule sans surprise, le regard indifférent des passants.
Pour saisir la complexité de cette réflexion, il faut entrer dans la tête de mon père ; mon père de cette époque-là, Le Tumultueux, Le Désabusé. Comprendre le cheminement tortueux, magistralement absurde, de sa pensée. Voir sous la couche de souffrance, par-delà l’âpreté de l’échec, les étendues de délicatesse et d’élégance, de respect et d’admiration. Apprécier la cohérence de sa décision (ne pas prendre d’escalator), et l’habilité avec laquelle il concentra en quelques mots, lui qui avait passé la majeure partie de son existence courbé sur une rame de papier à écrire, tout ce qu’il était devenu et tout ce que vous représentiez.
Mais vous le savez aussi bien que moi, pour prétendre entrer dans la tête d’un homme, il faut d’abord le connaître ; avaler toutes ses vies, toutes ses luttes, tous ses fantômes. Et croyez-moi, si je commence par là, si j’abats déjà la carte du « père », je n’arriverais plus à vous raconter ce que je m’apprête à vous raconter.
Restons sur l’impact de cette phrase : « L’escalator, c’est pour eux. » Raison qui m’a décidée, en partie, à entreprendre ce récit sans savoir par où commencer. Tout ce que je sais c’est que ces pages ne seront pas linéaires. Raconter le présent exige que je remonte loin dans le passé, que je traverse les frontières, survole les montagnes et rejoigne ce lac immense qu’on appelle mer, guidée par le flux des images, des associations libres, des soubresauts organiques, les creux et les bosses sculptés dans mes souvenirs par le temps. Mais la vérité de la mémoire est singulière, n’est-ce pas ? La mémoire sélectionne, élimine, exagère, minimise, glorifie, dénigre. Elle façonne sa propre version des événements, livre sa propre réalité. Hétérogène, mais cohérente. Imparfaite, mais sincère. Quoi qu’il en soit, la mienne charrie tant d’histoires, de mensonges, de langues, d’illusions, de vies rythmées par des exils et des morts, des morts et des exils, que je ne sais trop comment en démêler les fils.
Il est possible que certains d’entre vous me connaissent déjà, qu’ils se rappellent cet événement sanglant survenu à Paris, dans le 13e arrondissement, le 11 mars 1994. L’information fit l’ouverture du 20 heures de France 2. Le lendemain, tous les journaux en parlaient à travers des articles remplis de contre-vérités et ornés de photos de nous, les yeux barrés d’un rectangle noir. Peut-être m’avez-vous vue sur l’une d’entre elles. Peut-être avez-vous suivi l’affaire.
D’ailleurs, j’aurais pu commencer par là. Au lieu de vous parler d’escalator, j’aurais pu vous raconter ce que nous appelons entre nous L’ÉVÉNEMENT. Mais je ne peux pas. Pas encore. Pour l’instant, tout ce que vous avez besoin de savoir c’est que nous sommes le 19 janvier, il est dix heures dix et j’attends.
La désorientale.
Négar Djavadi.
Liana Levy, 2016.

 Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris