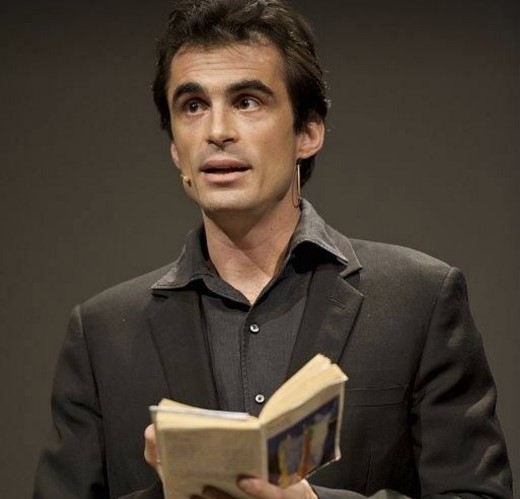Le piège du fanatisme
Le double piège du fanatisme
A tort ou à raison, nous associons le fanatisme à l’esprit religieux, c’est-à-dire à l’autorisation de tuer son prochain au nom du Seigneur. Issu du latin fanaticus, serviteur du temple, le substantif, dans son acception moderne, est inventé par Voltaire qui écrit en 1764 dans son Dictionnaire philosophique : « Le fanatisme est à la superstition ce que le transport est à la fièvre, ce que la rage est à la colère. (…) Ces gens-là sont persuadés que l’Esprit Saint qui les pénètre est au-dessus des lois. Que répondre à un homme qui vous dit qu’il aime mieux obéir à Dieu qu’aux hommes et qui, en conséquence, est sûr de mériter le ciel en vous égorgeant ? »
Tout irait pour le mieux si la première modernité, issue des Lumières, dans sa volonté de fabriquer un homme nouveau délivré de la superstition, de l’ignorance et de la misère, n’avait sombré à son tour dans un prosélytisme qui s’est cru immunisé de l’égarement par sa dénonciation des égarements religieux. Un fanatisme de l’Histoire s’est substitué au fanatisme de la foi. La croyance dans le Progrès a pris l’aspect d’une confession avec ses Grands Prêtres et ses Grands Inquisiteurs, alimentant, entre autres choses, les entreprises coloniales et impérialistes. Les hideuses religions séculières que furent le nazisme et le communisme n’avaient rien à envier aux pires théocraties dont elles se voulurent, au moins pour la seconde, la négation radicale. On a tué plus au XXe siècle contre Dieu qu’au nom de Dieu. Le totalitarisme est un fanatisme de la volonté, la certitude que tout ce qui existe peut-être transformé par la libre décision des hommes et que mérite la mort quiconque s’oppose à ce mouvement. Il n’empêche que nazisme et communisme ont été vaincus par des régimes démocratiques eux-mêmes inspirés des Lumières et fondés sur les droits de l’homme, la tolérance, le pluralisme. Après le désastre du XXe siècle, la modernité a donc appris la modestie, est devenue critique d’elle-même, a dénoncé la sacralisation d’une raison devenue folle, aveugle à son propre emballement.
On peut définir le fanatisme comme une maladie de la vérité en crise. Au sommet de leur gloire – songeons à l’Andalousie, à la Sublime Porte, aux Moghols en Inde – une dynastie, une obédience peuvent autoriser des vérités multiples, marginales, dialoguer avec d’autres monothéismes pourvu que leur suprématie ne soit pas contestée. Le fanatisme commence au moment où ce magistère est remis en cause : à partir de la Renaissance pour le catholicisme quand il vacille sous le double coup de boutoir de la Réforme et de l’humanisme ; dès I793 pour la Révolution française quand elle inaugure la Terreur et inscrit sur ses drapeaux « La liberté ou la mort ». Aujourd’hui même l’apostolat meurtrier des fous de Dieu ne prouve pas la vitalité de l’islam mais sa fragilité, celle d’une religion en proie à la discorde, frappée en son cœur par la modernité, privée d’un centre depuis la disparition du Califat. Le puissant sait se montrer magnanime, seul le faible doit tuer pour imposer ses raisons. Le fanatisme, en tant que sacralité dévoyée, est le symptôme d’un monde sans autrui, où tous doivent se plier à la même doctrine, au même catéchisme. Entrer dans l’ordre de l’argumentation pour le fanatique serait déjà reconnaître le caractère pluriel des normes et donc la validité de points de vue étrangers.
Réponse tragique à l’anxiété d’une certitude qui se dérobe, le fanatisme nous désarme deux fois : par la peur et par la contagion, quand il nous contamine à son tour de la rage. Face à lui, nous oscillons entre deux impasses : l’abdication ou le mimétisme. Dans un cas, nous n’osons plus défendre nos principes tant nous les confondons avec une exaltation malsaine. Depuis le XVIIIe siècle, les penseurs libéraux ont riposté à la fureur sectaire ou politique par un éloge de la modération et se sont posés en démobilisateurs. Mener à bien cette opération de salubrité mentale, c’était donc tempérer la fièvre messianique par le scepticisme, édulcorer les certitudes sanguinaires. Multiplier toujours et partout les raisons de douter, non de croire, telle est notre doctrine. Comment ne pas voir cependant que cette sagesse risque à terme de saper les fondements mêmes de l’action ? Si la démocratie désarme la foi, comment avoir assez de foi en la démocratie pour la défendre et la propager ? Ne risque-t-elle pas de devenir ce qui subsiste quand on ne croit plus à rien : le credo paresseux des désenchantés ?
De quoi avons-nous peur face aux divers intégrismes ? Moins de leur vigueur que de notre apathie, de la diminution de nos capacités de résistance. Ce pourquoi nos gouvernements, face à n’importe quelle agression pratiquent trop souvent la reculade, la compromission plutôt que d’affronter le mal. Autant le scepticisme peut être un contrepoids aux extrêmes, autant il rend les idéaux exsangues, les normes interchangeables. Tout se vaut alors, les sociétés pluralistes comme les autoritaires. Dans la grande nuit de l’équivalence, les égorgeurs valent les fidèles ordinaires. La tolérance engendre le relativisme lequel engendre l’indifférence à la tolérance et donc la complaisance à l’intolérable. Mais le fanatisme se nourrit des concessions qu’on lui fait : tel un brasier, il s’alimente à notre renoncement, se propage, se fortifie dès qu’on tente de l’apaiser. Et comme la démocratie est ce régime qui, pour se légitimer, ne cesse de se remettre en cause, elle est atteinte au cœur par ces idéologies qui ne font jamais l’expérience de la remise en question.
Deuxième cas de figure, il arrive que les nations libres réagissent avec violence à la violence qui leur est faite. Un danger les guette alors : celui d’imiter l’ennemi qui les frappe. C’est ce qui est arrivé, toutes proportions gardées, à l’Amérique de George Bush au lendemain du 11 Septembre 2001 : l’instauration de la loi des suspects par le Patriot Act, l’affaiblissement des libertés publiques au nom de la législation antiterroriste, les entreprises guerrières inutiles, la pratique de la torture et des enlèvements, les écoutes illégales, enfin l’hystérie hyperpatriotique d’une majorité de citoyens ont entraîné les Etats-Unis dans une contradiction fatale : pour défendre la démocratie, ils ont commencé par la détruire de l’intérieur. Le triste bilan de l’administration Bush aura été le réensauvagement légal de la société américaine et la dégradation durable de l’image des États-Unis. La culture de la mobilisation et de la peur a toujours constitué l’instrument favori des dictatures : les démocraties ne peuvent en faire qu’un usage limité sous peine de se désintégrer. Le risque existe dans ce genre de démarches d’épouser la logique de son adversaire pour mieux le défaire, de légiférer et de militariser à outrance, d’emprisonner sans raison. La gangrène est rapide qui mène une société libérale, au nom de la défense de ses valeurs, à sombrer dans une brutalité d’autant plus pernicieuse qu’elle se pare du drapeau de la liberté. Alors la sauvagerie devient licite, rien ne borne l’esprit de représailles, la cruauté se nourrit des exactions du camp d’en face. On en arrive à la remarque de Diderot selon lequel il est plus facile à un peuple éclairé de retourner à la barbarie que pour un peuple barbare d’avancer vers la civilisation.
Face au fanatisme, les démocraties disposent bien sûr de la force militaire et policière. Mais leur arme principale reste la douceur de leurs mœurs et leur vigueur intellectuelle : à l’ardeur des insensés, opposer l’ironie, l’incrédulité, la réfutation, mener partout la guerre des idées, encourager les modérés en isolant le noyau des kamikazes, prôner une gestion rationnelle des périls sans les minimiser ni les sur-estimer, offrir aux jeunesses désœuvrées l’issue autrement exaltante de la réussite individuelle, de l’enrichissement, de la solidarité. Se souvenir enfin que l’Europe a connu cette maladie de la croyance dévoyée, qu’elle en est sortie à grand-peine. C’est un combat quotidien, minutieux mais essentiel. Le refus de l’obscurantisme violent est une perpétuelle victoire sur nous-mêmes, sur notre lâcheté comme sur notre férocité potentielle. Les fanatiques nous tendent un double piège mortel : leur céder ou leur ressembler. « Veille en combattant un monstre à ne pas devenir un monstre toi-même » (Nietzsche).
Pascal Bruckner, Philosophe.

 Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris