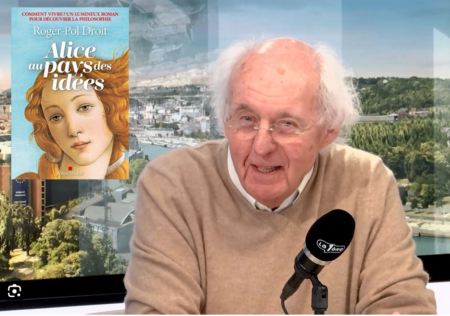Civilisation du spectacle
Tout comme la frivolité, la massification est un autre trait de la culture de notre temps. Le sport a pris une importance qu’il n’avait par le passé que dans la Grèce antique. Pour Platon, Socrate, Aristote et les philosophes de l’Académie, la culture du corps était complémentaire de la culture de l’esprit, l’un et l’autre s’enrichissant mutuellement. La différence aujourd’hui c’est que la pratique du sport se fait aux dépens et à la place du travail intellectuel. Parmi les sports, aucun n’a autant d’importance que le football, phénomène de masse qui, comme les concerts de musique moderne, mobilise les foules et les enflamme plus que toute autre chose: meetings politiques, processions religieuses ou manifestations civiques. Un match de football peut être assurément pour les supporters -j’en suis un – un spectacle formidable, dribble, jeu d’équipe, exploit individuel, qui enthousiasme le spectateur. Mais de nos jours les grands matches de football servent surtout, comme les cirques romains, de prétexte, défoulement de l’irrationnel, régression de l’individu au stade de la tribu, représentation grégaire où, sous couvert du chaud anonymat des tribunes, le spectateur donne libre cours à ses instincts agressifs, refus de l’autre, conquête et anéantissement symbolique (parfois même réel) de l’adversaire. Les fameuses barras bravas de certains clubs et les dégâts qu’elles provoquent dans leurs désordres homicides, incendies de tribunes et dizaines de victimes, montrent comment, dans bien des cas, ce n’est pas la pratique d’un sport qui attire tant de supporters _ presque toujours des hommes bien qu’on trouve de plus en plus de femmes à fréquenter les stades _, mais un rituel déchaînant chez l’individu instincts et pulsions qui contredisent sa condition civilisée pour le ramener à la horde primitive.
Paradoxalement, le phénomène de massification est parallèle à l’extension de la consommation de drogues à tous les niveaux de la pyramide sociale. Certes, l’usage des stupéfiants est d’ancienne tradition en Occident, mais jusqu’à récemment c’était l’apanage des élites et de groupes marginaux, comme les cercles de bohème, littéraire et artistique, où, au XIXe siècle, les fleurs artificielles avaient des adeptes aussi respectables que Baudelaire et Thomas De Quincey.
Actuellement la généralisation de l’usage des drogues n’est en rien comparable; elle ne répond pas à l’exploration de nouvelles sensations ou visions dans un but artistique ou scientifique. Elle ne manifeste pas non plus la révolte contre les normes établies d’êtres anticonformistes, adoptant des formes alternatives d’existence. De nos jours la consommation massive de marijuana, cocaïne, ecstasy, crack ou héroïne répond à un environnement culturel incitant hommes et femmes à rechercher des plaisirs faciles et rapides; ils les immunisent contre l’inquiétude et la responsabilité, au lieu de les aider à se retrouver par la réflexion et l’introspection – activités éminemment intellectuelles qui se révèlent ennuyeuses face à la culture velléitaire et ludique. Vouloir échapper au vide et à l’angoisse, à sa liberté, aux décisions à prendre – que faire de soi-même et du monde, face aux défis et aux drames? -, voilà ce qui attise ce besoin de distraction, le moteur de l’actuelle civilisation. Pour des millions de personnes les drogues, substituts aux religions et à la haute culture d’hier, servent à apaiser doutes et perplexité sur la condition humaine, la vie, la mort, l’au-delà, le sens et le non-sens de l’existence. Dans l’exaltation, l’euphorie ou l’apaisement artificiel qu’elles produisent, les drogues confèrent l’éphémère assurance d’être à l’abri, heureux et sauf. C’est là une fiction, néfaste dans ce cas, qui isole l’individu et ne le libère qu’en apparence des problèmes, des responsabilités et des angoisses. Car en fin de compte, le retour à la lucidité exigera des doses plus fortes d’étourdissement et de surexcitation qui ne feront que creuser son vide spirituel.
Dans la civilisation du spectacle la laïcité a apparemment pris le pas sur les religions. Et ceux qui sont encore croyants le sont le plus souvent par à-coups et pour la galerie, de façon superficielle et mondaine, fort loin de la religion. L’effet positif de cette sécularisation de la vie est que la liberté est maintenant plus profonde que lorsque les dogmes et censures ecclésiastiques la rognaient et l’asphyxiaient. Mais ce serait une erreur de croire qu’avec un pourcentage moindre de catholiques et de protestants dans le monde occidental la religion ait disparu des secteurs gagnés par la laïcité. À vrai dire, en même temps que de nombreux fidèles renonçaient aux Églises traditionnelles, on a vu proliférer sectes, cultes et toutes sortes de formes alternatives de pratique religieuse, depuis le spiritualisme oriental en toutes ses variantes – bouddhisme, zen, tantrisme, yoga – jusqu’aux Églises évangéliques qui pullulent maintenant, se divisent et subdivisent dans les quartiers marginaux, et ces succédanés pittoresques que sont la Quatrième Voie (Gurdjieff), l’Alliance Rose-Croix, l’Association de l’Esprit-Saint pour l’unification du christianisme mondial (la secte Moon)I, la scientologie, si populaire à Hollywood, et des Églises encore plus exotiques et épidermiques.
Cette prolifération d’Églises et de sectes prouve que bien peu d’êtres humains peuvent se passer totalement de religion. L’immense majorité réclame la foi religieuse qui rassure quant à la transcendance et libère l’âme de l’inquiétude, cette peur d’une extinction, d’une disparition totale. De fait, la religion est, pour la plupart, la seule façon d’entendre et de pratiquer une éthique. Seules quelques minorités s’émancipent de la religion en remplaçant par la culture le vide laissé dans leur vie: philosophie, science, littérature ou art. Mais c’est la haute culture qui peut remplir cette fonction, celle qui affronte les problèmes sans les esquiver, qui tente d’apporter des réponses sérieuses et non ludiques aux grandes énigmes ou interrogations et aux conflits qui entourent l’existence humaine. La culture superficielle et clinquante, celle du jeu et de la pose, est incapable de suppléer aux certitudes, mythes, mystères et rituels des religions qui ont survécu à l’épreuve des siècles. Dans la société de notre temps les stupéfiants et l’alcool fournissent cette paix momentanée de l’esprit et ces certitudes et soulagements que procuraient jadis les prières, la confession, la communion et les sermons des prêtres.
Rien d’étonnant non plus à voir les hommes politiques en campagne qui, auparavant, se faisaient photographier aux côtés d’éminents savants et dramaturges, rechercher aujourd’hui le parrainage de chanteurs de rock, d’acteurs de cinéma, de vedettes du foot et d’autres sports. Ces derniers ont remplacé les intellectuels comme directeurs de conscience politique des classes moyenne et populaire, et on les voit en tête des manifestes, à la une de la presse ou prêchant à la télé le bien et le mal dans le domaine économique, politique et social. Dans la civilisation du spectacle, le bouffon est roi. Par ailleurs, la présence d’acteurs et de chanteurs n’est pas seulement capitale dans la vie politique et l’opinion publique. Certains d’entre eux ont participé à des campagnes électorales et assumé, comme Ronald Reagan et Arnold Schwarzenegger, des charges aussi importantes que la présidence des États-Unis et le gouvernement de la Californie. Bien entendu, je n’exclus pas la possibilité que des acteurs de cinéma, des chanteurs de rock ou de rap, ou des joueurs de football puissent faire des suggestions estimables dans le domaine des idées, mais je réfute l’idée que le rôle politique qu’on leur fait jouer aujourd’hui ait quelque chose à voir avec leur lucidité ou leur intelligence. Il est dû exclusivement à leur présence médiatique et à leurs aptitudes histrioniques.
Car ce qui singularise la société contemporaine est l’éclipse d’un personnage qui depuis des siècles et jusqu’à relativement peu jouait un rôle important dans la vie des nations : l’intellectuel. Cette appellation d’« intellectuel» est née, dit-on, seulement au XIXe siècle, pendant l’Affaire Dreyfus, en France, et les polémiques déchaînées par Émile Zola avec son célèbre «J’accuse» – en défense de cet officier juif faussement accusé de trahison de la patrie par une conjuration de hauts gradés antisémites de l’armée française. Mais bien que le terme d’ «intellectuel» se soit popularisé seulement à partir d’alors, il est certain que la participation d’hommes de pensée et de création à la vie publique et aux débats politiques, religieux et d’idées remonte à l’aube même de l’Occident. Il fut présent dans la Grèce de Platon et la Rome de Cicéron, à la Renaissance avec Montaigne et Machiavel, au siècle des Lumières avec Voltaire et Diderot, à l’époque du romantisme avec Lamartine et Victor Hugo, et à toutes les périodes historiques qui ont conduit à la modernité. Parallèlement à leur travail de recherche, universitaire ou créatif, bon nombre d’écrivains et de penseurs renommés ont influé par leurs écrits, leurs révoltes et leurs prises de position sur les événements politiques et sociaux, comme cela se passait quand j’étais jeune, Sartre et Camus, en Italie avec Moravia et Vittorini, en Allemagne avec Günter Grass et Enzensberger, ainsi que dans presque toutes les démocraties européennes. Il suffit de penser, en Espagne, aux interventions dans la vie publique de José Ortega y Gasset et de Miguel de Unamuno. De nos jours, l’intellectuel a disparu des débats publics, du moins de ceux qui importent. Il est vrai qu’il en est encore pour signer des manifestes, envoyer des lettres aux journaux et s’empêtrer dans des polémiques, mais rien de cela n’a de répercussion sérieuse sur la marche de la société, dont les sujets économiques, institutionnels, voire culturels sont traités par le pouvoir politique et administratif, et par ce qu’on appelle les pouvoirs de fait, où les intellectuels brillent par leur absence. Conscients d’avoir été rejetés par la société où ils vivent, ils ont choisi, pour la plupart, la discrétion ou l’abstention dans le débat public. Confinés à leur discipline ou leur activité particulière, ils tournent le dos à ce qu’on appelait voici un demi-siècle «l’engagement» civique ou moral de l’écrivain et du penseur. Il y a des exceptions, mais parmi elles, celles qui comptent – parce qu’elles touchent les médias – sont davantage orientées vers l’autopromotion et l’exhibitionnisme que vers la défense d’un principe ou d’une valeur. Parce que, dans la civilisation du spectacle, l’intellectuel n’intéresse que s’il suit le jeu à la mode et devient un bouffon.
Mario Vargas Llosa.
LA civilisation du spectacle.
Gallimard, 2015.

 Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris