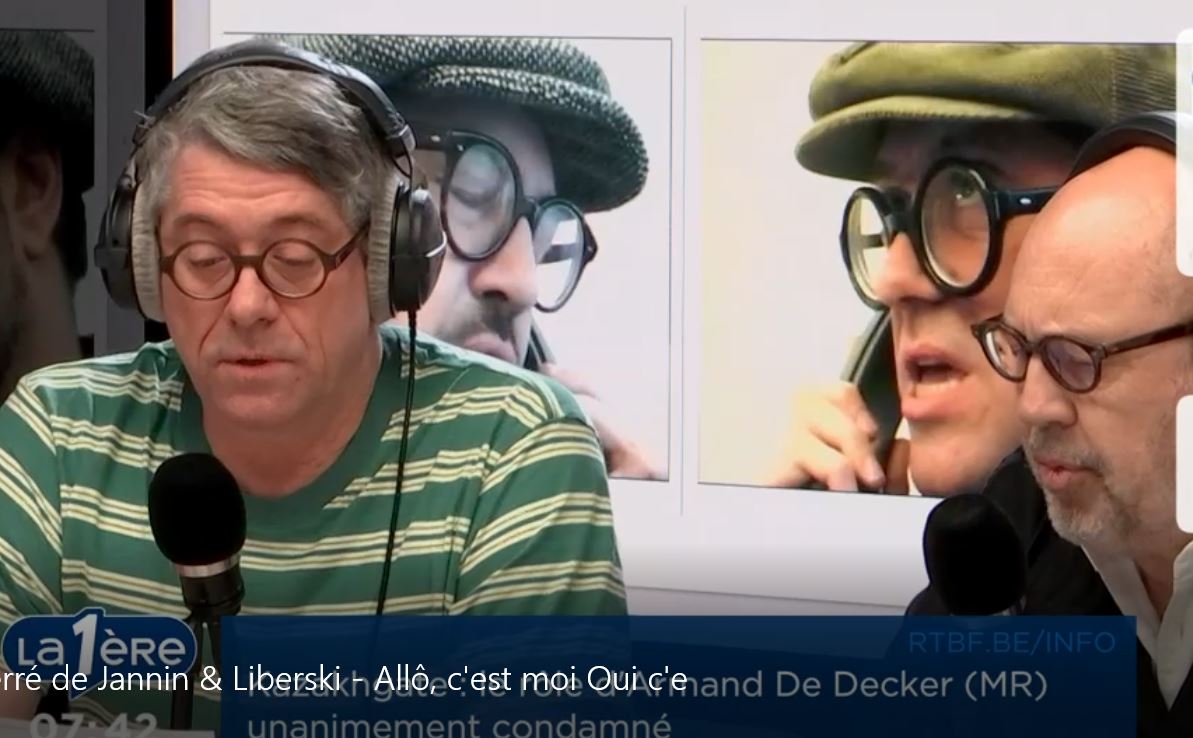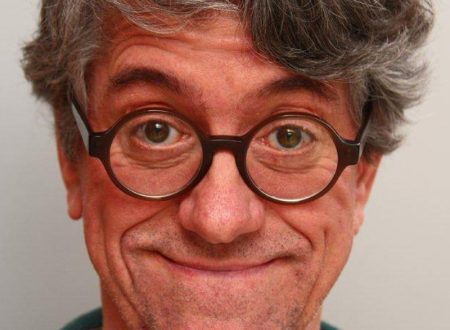Guerre et paix
Pourquoi la paix est un art autant que la guerre
J’étais face à un amphi, ce printemps 2017, à Conakry, pour traiter de la guerre et de la paix. Mon introduction se proposait d’accrocher l’attention du public, essentiellement guinéen, afin de l’entretenir de ce problème cruellement familier. Avec gravité, je soulignais à quel point, au fil des siècles, on s’était habitué à considérer la paix comme étant simplement la « non-guerre », acceptant ainsi, comme un triste aveu, que la belligérance fût installée à tout jamais dans les profondeurs de la nature humaine. L’idée me semblait banale tant elle avait été validée par une cohorte de philosophes, penseurs et savants de tout acabit. Elle relevait même de la rhétorique courante, jusqu’à celle du café du commerce. Glorieusement initiée par Héraclite, au VIe siècle avant notre ère, cette conception rendait trop de services à trop de monde, hélas, pour être abandonnée facilement. Un jeune Peul se dressa alors sur son siège pour m’adresser la plus rassurante des objections : « Chez nous, en langue pulaar, la paix a un sens positif et veut dire la santé morale et physique du groupe. » Tel est en effet le sens de njamu, proche aussi d’un autre mot qui me fut indiqué, weltaare, la « réjouissance du cœur ». J’appris un peu plus tard que la paix chez les Haoussa voisins se disait lafiha, la « tranquillité de l’esprit ».
La remarque ouvrait des perspectives passionnantes. Elle suggère déjà qu’on ne s’est pas suffisamment attardé sur le sens des mots politiques, croyant naïvement, sur le continent des Lumières, que nous les avons tous définis chez nous et pour l’éternité. Cette posture est bien imprudente quand on sait que le temps fait son œuvre et érode le sens de tout, y compris de la paix. Elle l’est encore plus à l’époque de la mondialisation, alors que les relations internationales ne se limitent plus à l’entre-soi et à des querelles de cousinage : comment faire la paix avec l’Autre lointain quand déjà nous ne nous entendons pas sur le sens profond d’un mot si important ? Il faut certes garder mesure, car, dans toutes les langues, la polysémie est de rigueur : un Français, un Anglais ou un Allemand ne sauraient être désorientés par cette acception assimilant paix et tranquillité qui appartient aussi à notre langage quotidien, celui de toute personne exaspérée qui réclame « la paix ! ».
L’art de la paix.
Bertrand Badie.
Flammarion, 2024.

 Ajouter aux favoris
Ajouter aux favoris